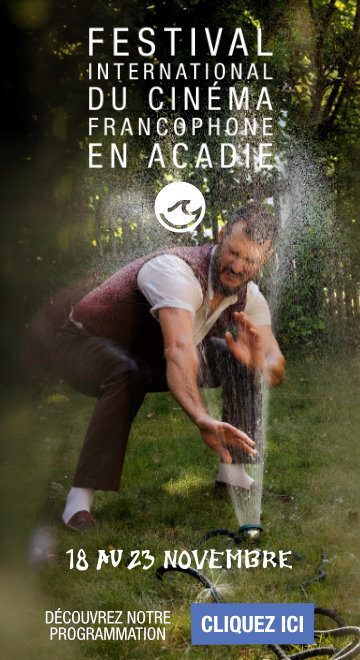Éditorial
25 Avril 2025
Une empreinte de lumière dans la noirceur du monde
- Partager
Damien Dauphin
damien@moniteuracadien.ca
Le pape est mort. Les mots raisonnent dans la gorge comme une pierre tombale que l’on scelle.
François incarnait l’impossible tension entre l’Église et le monde. Il était le jésuite au souffle poétique, le franciscain travesti d’un manteau blanc, le doux subversif, l’homme des périphéries, celui dont la parole suait le kérosène des marginalités.
.
L’histoire, qui ne respecte que ceux qui la dérangent, le retiendra peut-être comme le dernier pape-prophète, ou le premier pape de l’après-monde — celui qui a vu que le trône de Pierre ne repose plus sur l’or, mais sur la glaise.
Le pape est mort.
Mais il ne s’agit pas seulement d’un décès, d’une disparition, d’un effacement du corps sous le poids des cierges. Il s’agit d’un événement total, d’une onde de choc qui traverse les strates de l’histoire, de la symbolique, de la spiritualité, et de la psyché humaine.
Car la papauté n’est pas un gouvernement. Elle est un nœud vertical dans la trame horizontale du monde, un point d’orgue entre la glaise et l’étoile, entre l’éthique et le mystère, entre l’angoisse humaine et la paix indicible. Elle est ce qu’aucune autre institution n’ose plus être: une promesse silencieuse de verticalité dans un monde liquéfié.
Et voilà que cette verticalité vacille.
Nous vivons une époque où la figure du Père est haïe ou absente, où les archétypes sont dissous dans l’algorithme, et où l’Église se débat pour ne pas sombrer dans l’insignifiance.
La mort du pape François n’est pas une page qui se tourne: c’est peut-être le dernier souffle audible d’une ère où l’on croyait encore à la parole inspirée.
Le pape François était un mythe vivant, non par la grandeur, mais par l’inattendu: il renversait la figure du souverain, il riait, il embrassait les lépreux modernes, il dénonçait les puissants. Il était le mythe inversé du pouvoir comme humilité. Avec sa mort, ce mythe s’éteint momentanément — et avec lui, la possibilité d’un autre modèle de sacralité.
Le pape est mort, et avec lui, c’est tout un pan de l’histoire du christianisme qui semble suspendre sa respiration. Car la papauté, qu’on la vénère ou qu’on la critique, est une anomalie historique persistante, une institution née dans la cendre des empires et qui, contre toute logique politique, a traversé les siècles comme une énigme debout.
C’est une épopée spirituelle qui débute avec Pierre, le pêcheur instable, colérique, fidèle et lâche tout à la fois. Un homme qui renia, mais que le Christ choisit quand même pour porter les clefs du Royaume. C’est là que tout commence: dans la tension brutale entre la fragilité de l’homme et la sur-responsabilité divine dont il hérite. Cette tension ne cessera jamais de hanter l’histoire pontificale.
François est un pasteur sud-américain, formé à la poussière et au doute. Il refuse les appartements, les chaussures rouges, les carrosses. Il marche. Il serre les mains. Il parle de climat, de migrants, de frontières, d’économie. Il fait du politique avec du spirituel, sans tomber dans l’idéologie.
Son pontificat est l’épiphanie d’une Église qui doute d’elle-même tout en tentant de rester fidèle à sa mission. Il n’a pas régné: il a accompagné. Et c’est peut-être cela, la révolution silencieuse qu’il a offerte à l’histoire de la papauté: le retour à la pauvreté comme posture existentielle, non pas morale, mais ontologique.
Il est permis de penser qu’il fut le dernier pape à parler un langage intelligible aux deux mondes: celui d’en haut, et celui d’en bas. Le dernier à tenter la synthèse entre tradition et mutation, entre la Croix et la crise écologique.
François, dans sa douceur sévère, n’aura pas dominé. Il aura accompagné la chute de l’ancien monde avec les mots des prophètes et la tendresse des infirmes. Il aura été le dernier témoin d’une parole fragile, et peut-être le premier pape à nous dire que le trône de Pierre peut aussi être un banc de bois, un souffle sur la joue, un silence en prière.
La mort du pape n’est pas une fin. C’est un miroir. Elle nous renvoie à ce que nous avons perdu: le sens du seuil, l’intuition de la Présence, l’expérience de l’invisible. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des sujets modernes, rationnels, connectés — mais aussi des orphelins d’Absolu, des exilés du Mystère.
La mort d’un pape est moins un décès qu’une implosion symbolique, un effacement dans l’axe vertical du monde. C’est l’éclipse d’un point d’intersection entre le temps et l’éternité, entre la poussière anthropologique et la fulgurance métaphysique. Le pape, dans l’économie spirituelle de l’Église, n’est pas une autorité: il est une plaie ouverte dans le tissu du visible, un seuil vivant.
Il est cet homme debout entre la croix et le monde, tendu comme un funambule sur le fil du mystère, trop humain pour être divin, trop divin pour être seulement humain. Sa mort n’est donc pas une interruption: elle est une béance, un vide oraculaire qui exige de chacun un sursaut intérieur.
Il n’y a rien de plus spirituellement violent que le mutisme de Dieu quand son vicaire meurt. Il n’y a plus de parole. Il n’y a plus d’oreille pour l’entendre. Il ne reste que le vertige d’une absence pleine, une densité de vide qui brûle.
La mort du pape n’est pas seulement une fin: c’est un test pour l’eschatologie contemporaine, une provocation à l’espérance. Il faut continuer à croire que quelque chose résiste dans la poussière. Que le manteau blanc, déposé, ne soit pas un vêtement de renoncement, mais une empreinte de lumière.
Sa disparition laisse un vide qui ne sera pas comblé par l’élection d’un autre, car la fonction pontificale n’est pas une substitution: c’est une personnification éphémère du transcendant dans un individu historique.
Théâtre liturgique, politique, ésotérique, un conclave va pourtant s’amorcer. Les murs de la chapelle Sixtine enfermeront bientôt les doutes, les ambitions, les alliances. Mais qui pourra succéder à François sans en trahir l’esprit? Qui pourra reprendre la croix sans la transformer en sceptre?
Il ne s’agit pas seulement de choisir un nouveau nom: il s’agit de nommer l’innommable, de redonner un visage au berger qui sera chargé de guider ses brebis et d’incarner l’Église dans un temps où l’incarnation elle-même semble suspecte.
Et peut-être est-ce là, au fond, le dernier enseignement du pontife défunt: nous ne pouvons plus nous reposer sur un homme, un trône, une institution. Nous devons réapprendre à incarner, chacun, dans la faille de nos existences, un fragment du pont entre la Terre et le Ciel.
Le monde n’attend pas un nouveau pape. Il attend que l’humanité se rappelle ce qu’elle est: un souffle entre deux abîmes, et qu’elle ose, dans l’intervalle, bénir.
damien@moniteuracadien.ca
Le pape est mort. Les mots raisonnent dans la gorge comme une pierre tombale que l’on scelle.
François incarnait l’impossible tension entre l’Église et le monde. Il était le jésuite au souffle poétique, le franciscain travesti d’un manteau blanc, le doux subversif, l’homme des périphéries, celui dont la parole suait le kérosène des marginalités.
.
L’histoire, qui ne respecte que ceux qui la dérangent, le retiendra peut-être comme le dernier pape-prophète, ou le premier pape de l’après-monde — celui qui a vu que le trône de Pierre ne repose plus sur l’or, mais sur la glaise.
Le pape est mort.
Mais il ne s’agit pas seulement d’un décès, d’une disparition, d’un effacement du corps sous le poids des cierges. Il s’agit d’un événement total, d’une onde de choc qui traverse les strates de l’histoire, de la symbolique, de la spiritualité, et de la psyché humaine.
Car la papauté n’est pas un gouvernement. Elle est un nœud vertical dans la trame horizontale du monde, un point d’orgue entre la glaise et l’étoile, entre l’éthique et le mystère, entre l’angoisse humaine et la paix indicible. Elle est ce qu’aucune autre institution n’ose plus être: une promesse silencieuse de verticalité dans un monde liquéfié.
Et voilà que cette verticalité vacille.
Nous vivons une époque où la figure du Père est haïe ou absente, où les archétypes sont dissous dans l’algorithme, et où l’Église se débat pour ne pas sombrer dans l’insignifiance.
La mort du pape François n’est pas une page qui se tourne: c’est peut-être le dernier souffle audible d’une ère où l’on croyait encore à la parole inspirée.
Le pape François était un mythe vivant, non par la grandeur, mais par l’inattendu: il renversait la figure du souverain, il riait, il embrassait les lépreux modernes, il dénonçait les puissants. Il était le mythe inversé du pouvoir comme humilité. Avec sa mort, ce mythe s’éteint momentanément — et avec lui, la possibilité d’un autre modèle de sacralité.
Le pape est mort, et avec lui, c’est tout un pan de l’histoire du christianisme qui semble suspendre sa respiration. Car la papauté, qu’on la vénère ou qu’on la critique, est une anomalie historique persistante, une institution née dans la cendre des empires et qui, contre toute logique politique, a traversé les siècles comme une énigme debout.
C’est une épopée spirituelle qui débute avec Pierre, le pêcheur instable, colérique, fidèle et lâche tout à la fois. Un homme qui renia, mais que le Christ choisit quand même pour porter les clefs du Royaume. C’est là que tout commence: dans la tension brutale entre la fragilité de l’homme et la sur-responsabilité divine dont il hérite. Cette tension ne cessera jamais de hanter l’histoire pontificale.
François est un pasteur sud-américain, formé à la poussière et au doute. Il refuse les appartements, les chaussures rouges, les carrosses. Il marche. Il serre les mains. Il parle de climat, de migrants, de frontières, d’économie. Il fait du politique avec du spirituel, sans tomber dans l’idéologie.
Son pontificat est l’épiphanie d’une Église qui doute d’elle-même tout en tentant de rester fidèle à sa mission. Il n’a pas régné: il a accompagné. Et c’est peut-être cela, la révolution silencieuse qu’il a offerte à l’histoire de la papauté: le retour à la pauvreté comme posture existentielle, non pas morale, mais ontologique.
Il est permis de penser qu’il fut le dernier pape à parler un langage intelligible aux deux mondes: celui d’en haut, et celui d’en bas. Le dernier à tenter la synthèse entre tradition et mutation, entre la Croix et la crise écologique.
François, dans sa douceur sévère, n’aura pas dominé. Il aura accompagné la chute de l’ancien monde avec les mots des prophètes et la tendresse des infirmes. Il aura été le dernier témoin d’une parole fragile, et peut-être le premier pape à nous dire que le trône de Pierre peut aussi être un banc de bois, un souffle sur la joue, un silence en prière.
La mort du pape n’est pas une fin. C’est un miroir. Elle nous renvoie à ce que nous avons perdu: le sens du seuil, l’intuition de la Présence, l’expérience de l’invisible. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des sujets modernes, rationnels, connectés — mais aussi des orphelins d’Absolu, des exilés du Mystère.
La mort d’un pape est moins un décès qu’une implosion symbolique, un effacement dans l’axe vertical du monde. C’est l’éclipse d’un point d’intersection entre le temps et l’éternité, entre la poussière anthropologique et la fulgurance métaphysique. Le pape, dans l’économie spirituelle de l’Église, n’est pas une autorité: il est une plaie ouverte dans le tissu du visible, un seuil vivant.
Il est cet homme debout entre la croix et le monde, tendu comme un funambule sur le fil du mystère, trop humain pour être divin, trop divin pour être seulement humain. Sa mort n’est donc pas une interruption: elle est une béance, un vide oraculaire qui exige de chacun un sursaut intérieur.
Il n’y a rien de plus spirituellement violent que le mutisme de Dieu quand son vicaire meurt. Il n’y a plus de parole. Il n’y a plus d’oreille pour l’entendre. Il ne reste que le vertige d’une absence pleine, une densité de vide qui brûle.
La mort du pape n’est pas seulement une fin: c’est un test pour l’eschatologie contemporaine, une provocation à l’espérance. Il faut continuer à croire que quelque chose résiste dans la poussière. Que le manteau blanc, déposé, ne soit pas un vêtement de renoncement, mais une empreinte de lumière.
Sa disparition laisse un vide qui ne sera pas comblé par l’élection d’un autre, car la fonction pontificale n’est pas une substitution: c’est une personnification éphémère du transcendant dans un individu historique.
Théâtre liturgique, politique, ésotérique, un conclave va pourtant s’amorcer. Les murs de la chapelle Sixtine enfermeront bientôt les doutes, les ambitions, les alliances. Mais qui pourra succéder à François sans en trahir l’esprit? Qui pourra reprendre la croix sans la transformer en sceptre?
Il ne s’agit pas seulement de choisir un nouveau nom: il s’agit de nommer l’innommable, de redonner un visage au berger qui sera chargé de guider ses brebis et d’incarner l’Église dans un temps où l’incarnation elle-même semble suspecte.
Et peut-être est-ce là, au fond, le dernier enseignement du pontife défunt: nous ne pouvons plus nous reposer sur un homme, un trône, une institution. Nous devons réapprendre à incarner, chacun, dans la faille de nos existences, un fragment du pont entre la Terre et le Ciel.
Le monde n’attend pas un nouveau pape. Il attend que l’humanité se rappelle ce qu’elle est: un souffle entre deux abîmes, et qu’elle ose, dans l’intervalle, bénir.